Bonjour tout le monde ! Je vous retrouve ce mois-ci pour une nouvelle Newsletter. J’y parle du rapport entre mes études en école d’ingénieur et ma passion pour cinéma, de ma difficulté à y trouver ma place de temps à autre et du rapport que je vois entre Sciences et Arts. Vous trouverez en annexe un résumé des films du mois et des nouvelles de mon documentaire.
N’hésitez pas à suivre mon compte Instagram @laissetomberlesfilms davantage de discussions !
Bonne lecture !
Préambule
Samedi dernier, je prends le RER B jusqu’à Châtelet pour prendre un brunch à l’extérieur avec deux amies. C’est un rendez-vous spécial, parce que je vois mon amie Héloïse, mais aussi Caroline, que je n’ai pas revue depuis 10 ans ; l’année où j’ai quitté le Qatar (pays dans lequel j’ai vécu trois ans).
Caroline était ma première amie quand je suis arrivée à Doha, et la discussion avec elle se fait très facilement. En dix ans, nous ne nous sommes pas parlé pendant sept, et nous nous sommes échangé quelques vocaux de plusieurs minutes en 2020, à l’heure du confinement. Tout cela une fluidité surprenante compte tenu de la distance physique et temporelle qui nous séparait. Elle suscite vite en moi ce sentiment de complicité que j’ai seulement avec les personnes de Doha : après toutes ces années, c’est comme si l’on s’était quittées seulement hier.
Ma discussion avec Caroline me permet de lui présenter la “nouvelle” version de moi. Où j’en suis, ce que je fais. J’en viens à la tâche régulière de me présenter, exercice qui m’apportait une certaine insatisfaction jusqu’il y a peu. Avec mon morceau de phrase étudiante-en-double-diplôme-commerce-et-ingénierie-et-alternante-dans-l-énergie, j’avais l’impression de me réduire considérablement, et qu’une voix intérieure me poussait avec volonté : “dis plutôt que tu aimes le cinéma” !
Depuis quelques temps, j’ajoute souvent en suffixe de ma subordonnée “et j’ai aussi des projets de cinéma”. En me présentant simplement par mes études et mon activité pro, j’avais la sensation désagréable de me tronquer, mais surtout de mentir à la personne en face de moi : j’aurais beaucoup de mal à décrire mes activités quotidiennes sans parler du cinéma, de mon attachement pour cet art.
Au cours de la discussion, on en revient à nos années passées. Caro me dit “Tu aimais bien les maths, toi, non ?”. Ce à quoi j’aurais pu répondre par un simple oui, mais je tergiverse vite en disant que les sciences m’ont toujours plu, que je sens aujourd’hui une certaine déconnexion par rapport à ce que j’aimais vraiment lors de mes années lycée, notamment par la variété des matières parfois trop éloignées des mathématiques en école d’ingénieur. J’entrevois la fin de mon histoire avec les maths, alors que j’avais fait ce double diplôme pour justement “continuer les maths parce que j’ai surtout pas envie d’arrêter les maths”. Je finis par dire que finalement c’est l’art qui peut toujours nous accompagner dans la vie, notamment de par son accessibilité. Alors qu’en maths on peut vite se sentir largué lorsque le contact quotidien manque, j’ai en effet pu revenir cent ou mille fois au cinéma après quelques abandons divers (entre autres, mes deux années de prépa).
Une simple question sur mes années collège m’amène automatiquement à faire la distinction entre sciences et arts, et même à les opposer comme une contradiction. Pourtant, je suis loin d’avoir toujours adhéré à cette distinction.
Dichotomie sciences-arts
Dans le dernier film de Steven Spielberg, The Fabelmans, le réalisateur nous décrit son enfance et la naissance de sa passion pour le cinéma. Avec un père ingénieur de renom, et une mère pianiste passionnée, le jeune Sam se retrouve tiraillé entre les ambitions que son père a pour lui, son attachement à sa famille, et sa passion pour la réalisation de films. Sa mère, jouée par Michelle Williams, finit pas dire à un repas de famille : “Ici, c’est toujours la guerre entre les scientifiques et les artistes”.
Pour autant que j’en sois témoin, entre Sciences et Arts se joue un formidable combat de coqs. Dès la première, lorsque j’ai choisi la filière S, nous débattions avec mes amies en L notre charge de travail, de l’importance de nos matières, de ce que les unes savaient et les autres non. Des discussions remplies d’égo et parfois frisant des tensions réelles, comme si l’on prenait pour acquis que nos personnalités étaient désormais façonnées par les mots de “scientifique” et “littéraire”. En y repensant maintenant, je me rends compte à quel point le titre de la filière m’a rapidement catégorisée comme scientifique, sans que mes aspirations aient un rapport direct avec cela.
Jusqu’à la S, je ne pensais pas avoir à choisir entre la science et l’art. Pour moi, il était assez naturel que le français était aussi important que les maths, les deux matières semblant faire l’étendard de ces domaines.
Comme je nourris activement ma passion pour le cinéma depuis la seconde (dix ans, en fait !), mon envie de faire des maths était, à l’époque, loin d’être décorrélée de ma passion pour le cinéma. Comment savoir quelle envie a-t-elle alimenté l’autre ? Lorsque je suis sortie bouleversée de mon premier visionnage du film The Imitation Game, en 2015, j’étais persuadée que c’était parce que j’aimais les maths. J’achetais alors The Code Book (Histoire des Codes Secrets en français) de Simon Singh, à la Fnac, un livre qui m’a changée en m’apprenant la rivalité entre cryptographe et cryptanalyste qui existait depuis la nuit des temps. Se lisant comme un roman, cet ouvrage documentaire de maths et de langues achevait de me convaincre de la dimension vibrante des maths.
Mais en y repensant, je crois que c’est mon amour du cinéma qui a alimenté mon envie de faire des maths. C’est le fait de voir les mathématiques en images, dans une trame tragique et sous des plans saisissants dans le film de Morten Tyldum, qui m’a fait croire aux destins extraordinaires provoqués par les sciences. C’est à travers l’art cinématographique que j’ai tendu à les apprécier davantage, et à me plonger dedans.
De la même manière, petite, je connaissais tout du naufrage du Titanic, voire même de son architecture allant jusqu’à sa taille et son poids ; après avoir visionné le fameux film de James Cameron. Mon intérêt pour le paquebot provenait-il du cinéma, ou bien l’histoire m’aurait-elle parue fascinante dans tous les cas ?
C’est en visionnant un biopic un peu mauvais sur Michael Jackson sur TF1, au lendemain de sa mort, que je me suis mise à écouter ses musiques en boucle et à en devenir une véritable groupie posthume.
En bref, en ce qui me concerne, ce phénomène s’est largement trop produit pour que je ne doute plus de qui est arrivé en premier (la poule ou l’oeuf ?) : c’est la claque que me fait connaître le cinéma qui développe mes passions, et moins mes passions qui me rendent sensible au cinéma.
Dans l’envie de me diversifier, je peux me demander si je ne suis pas trop centrée sur le cinéma plutôt que sur d’autres sujets et d’autres arts. Mais je me rend souvent compte que le cinéma est ma fenêtre ouverte sur le monde. C’est le cinéma qui me porte naturellement à d’autres sujets, qui me place dans la peau de l’autre de par son pouvoir de transcender les choses.
Claude Lellouche affirme que pour lui, la salle de cinéma est le plus beau pays du monde. Et ceci parce que terriblement, elle renvoie à des multiples contrées, les univers infinis et incommensurables des réalisateurs.
Un choix français
Margot, une amie qui a passé un semestre en Californie pour étudier le commerce et le secteur du divertissement, me faisait part du naturel avec lequel les américains mélangeaient les domaines sans en faire tout un plat. Certains étudiants de son université avaient une majeure en “business” (commerce), et une mineure en “drama” (théâtre) ; et passaient des auditions lorsqu’ils n’étaient pas en cours. Autrement dit, être un acteur qui étudie le commerce ne serait pas quelque chose de farfelu aux Etats-Unis.
Cette discussion avec Margot m’a fait réaliser que la dichotomie entre sciences et arts, la bizarrerie que l’on entrevoyait dans le fait de mélanger nos disciplines de prédilection, ou simplement le phénomène de spécialisation extrême dans un domaine, est quelque chose de très français.
Le fait de savoir qu’il ne s’agissait que d’une perception culturelle plutôt que d’une fatalité m’a largement libérée intérieurement. Je continue parfois, pour expliquer mon grand intérêt pour le cinéma alors que je suis en école d’ingénieur, à dire aux autres “j’ai dû me tromper quelque part dans mon orientation”. Pourtant, je n’ai pas du tout le sentiment d’avoir fait une erreur quelque part, loin de là. Le fait que mon premier long-métrage en production se situe dans mon école d’ingénieur en est probablement une preuve. Ce sont ces expériences qui m’ont construites et m’ont permis de faire grandir ma passion pour le cinéma.
Il est certain que j’aurais eu une culture cinématographique plus solide, et une expertise appréciable, si j’étais passée par une école ou une licence de cinéma plutôt que de me lancer dans des études en partant un peu dans tous les sens. Reprendre des études dans le cinéma est d’ailleurs quelque chose qui m’attire vraiment, et que j’espère avoir l’occasion d’entreprendre un jour. Cela dit, je pense que mon chemin jusque là ne contient pas de faux pas, et me permet de voir le cinéma à ma manière.
Au moment de vouloir réaliser mon premier court-métrage, je me suis vite sentie dépassée et découragée par l’entourage d’étudiants en cinéma autour de moi. J’avais largement honte de mon travail en comparaison aux leurs, et l’impression de me tourner en ridicule en m’essayant à quelque chose pour lequel je n’avais aucune compétence particulière, et où seule la passion et un vague rêve me guidaient. Finalement, la seule pensée qui m’a amenée à continuer était qu’il fallait bien “commencer quelque part”, et qu’il était toujours moins ridicule de s’essayer à faire quelque chose que de ne rien faire du tout (d’autre part, mes cours de théâtre m’ont largement appris que le ridicule ne tue pas, et heureusement !). Une autre pensée qui me bloquait était celle de ne pas avoir saisi les opportunités de réaliser des courts métrage plus tôt, notamment dans mes associations en école. Je me disais que si j’étais vraiment passionnée au point de vouloir devenir réalisatrice, je me serais davantage investie dans l’audiovisuel quand j’en avais l’occasion, et avec les conditions en or que les écoles de commerce et d’ingénieur m’offraient.
Aujourd’hui, je pense que le “social”, qui fait entrer en jeu l’apparence, le fait d’être “cool” ou non, faisait beaucoup trop partie de ces associations pour que je sois suffisamment à l’aise pour y développer ma créativité. Dans des milieux pouvant être extrêmement hostiles à l’estime de soi, voire la miner complètement, et où le jugement est constamment présent, j’ai aujourd’hui encore beaucoup de mal à comprendre comment il aurait été possible de réellement oser développer ma créativité, et j’ai une grande admiration pour ceux qui ont su faire croître leurs compétences (en audiovisuel ou autres) dans ces conditions-là.
Ingénierie du cinéma
L’école d’ingénieur reste tout de même liée au cinéma au-delà des associations. J’en passe sur le fait que l’art accorde une grande importance aux mathématiques et notamment l’art visuel, puisque l’un et l’autre se nourrissent. Une preuve flagrante est cette géométrie adoptée dans certains plans du film Parasite, où une ligne subtile à l’écran sépare presque systématiquement les deux familles.
On ne saurait oublier que le cinématographe est un outil sortant de l’ingénierie. Auguste Lumière suivra un cycle de mathématiques spéciales lors de ses études supérieures, après avoir envisagé l’école Polytechnique. Louis Lumière, lui, est un “féru de chimie” et c’est ce qui le propulsera dans la création de machines. Dans mes préparations de tournage, je me confronte sans cesse à une ribambelle d’aspects techniques lourds et complexes qui me rappelle sans encombre mes cours en école d’ingénieur.
Cela souligne l’idée que le cinéma n’est pas grand chose sans la technique, et pourtant une pure technique ne donne pas grand intérêt au cinéma. Une amie me disait récemment avoir détesté Avatar 2. Sans en nier les prouesses techniques, elle m’expliquait que pour elle, celles-ci ne valaient rien si elle ne constituaient qu’un “vomi de couleurs” et que la technique pour la technique ne sert à rien. Je ressentais la même chose au visionnage de Decision to leave de Park Chan Wook, que j’ai trouvé tristement beau visuellement, car au service, selon moi encore une fois, d’aucun scénario (ou d’un semblant de Basic Instinct trempé dans encore plus de male gaze).
En bref, je pense que la technique et l’art se complètent. Je n’arrive pas à créer de réelle hiérarchie entre les deux domaines, tant ils peuvent aussi s’entremêler. Ce plan tiré de Everything Everywhere All At Once, dernier lauréat de l’Oscar du meilleur film (et d’un certain nombre d’autres Oscars), en est pour moi une belle illustration : que serait cette image sans technique, mais que serait-elle le scénario qu’elle transporte ?
Inutile
Dans The Imitiation Game, l’histoire d’Alan Turing est montrée sous le prisme suivant : les maths peuvent sauver des vies. J’étais au lycée à l’époque de sa sortie, et la problématique “à quoi servent les maths” surgissait à rebours. Que ce film en donne une réponse toute faite en invoquant la plus haute des tâches (l’héroïsme et celui de sauver des vies pendant la guerre), donnait de quoi répondre à tout détracteur voyant les maths comme un “jeu” un peu décalé.
J’aimais beaucoup cette maxime héroïque qui s’accolait aux mathématiques, et l’idée que l’ingénierie, pourtant souvent montrée comme délétère pour la paix dans le monde, pouvait en fait s’atteler à son maintien, me donnait un sentiment d’urgence à faire des maths et à en apprendre davantage.
Pourtant, j’ai pensé une fois en classe prépa que c’était le côté “inutile” des maths qui en faisaient leur beauté.
A la fin de la pièce d’Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, le protagoniste éponyme se livre à une bataille fictive contre son dernier ennemi : la mort. L’extrait suivant s’ensuit.
Le “c’est bien plus beau lorsque c’est inutile” m’est devenu très cher au fil des années, notamment à mon passage à l’âge adulte alors que la productivité et la rentabilité s’impose toujours un peu plus comme objectifs naturels et principaux.
Lorsque je pense que les maths sont inutiles, autrement dit, que les exercices de maths que j’ai pu faire ou que les découvertes théoriques que j’ai eu en licence, ne servent simplement qu’à la théorie et à rien de plus, mon admiration pour les maths n’en est que plus forte. C’est cette inutilité qui montre finalement un désintérêt grandiose, quelque chose en effet de “bien plus beau”.
Dans le film Le Cercle des Poètes Disparus, l’utilité de l’art est aussi au coeur du débat, notamment dans le court monologue de Robin Williams sur la poésie, la beauté, la romance et l’amour.
We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. To quote from Whitman, "[…] what good amid these, O me, O life?" Answer. That you are here - that life exists, and identity; that the powerful play goes on and you may contribute a verse. That the powerful play goes on and you may contribute a verse. What will your verse be?
Nous ne lisons et n'écrivons pas de la poésie parce que c'est mignon. Nous lisons et écrivons de la poésie parce que nous faisons partie de la race humaine. Et la race humaine est remplie de passion. La médecine, le droit, le commerce, l'ingénierie sont des activités nobles et nécessaires au maintien de la vie. Mais la poésie, la beauté, le romantisme, l'amour, c'est pour cela que nous sommes en vie. Pour citer Whitman, […] à quoi cela sert-il, O moi, O vie ?" Réponse. Que vous êtes ici - que la vie existe, et l'identité ; que la pièce puissante continue et que vous pouvez contribuer à un vers. Que la pièce puissante continue et que vous puissiez y contribuer. Quel sera votre couplet ?
Bien que le personnage de Robin Williams place l’ingénierie dans les disciplines nobles qui sont nécessaires au maintien de la vie, j’espère que dans ma théorie, l’art et les sciences puissent se rejoindre et se parler dans leur inutilité. Qu’il s’agit de leur grand point commun, d’avoir une âme transparente et sans but de profit.
Voilà, c’est (presque) la fin de cette Newsletter ! J’espère que cela vous a plu. Je vous invite à retrouver en annexe mon résumé des films vus ce mois-ci ainsi que des nouvelles de mon documentaire “Au bout du B”.
Annexe
Les films du mois
Je vous parle ici de mon avis sur les films que j’ai vus ce mois-ci. N’hésitez pas à me faire un retour si vous en avez vu certains !
The Whale
J’ai pris la claque que je ne pensais pas prendre de si tôt cette année.
The Whale infuse lentement en moi comme du bon thé. Plus les jours passent, plus je pense et repense à ce texte, à ce film, à Brendan Fraser, à Charlie.
Impossible d’exprimer en quelque ligne l’effet de ce film, sa multiplicité, son bonheur et son malheur. Je me sens plus légère à la fin de la séance et pourtant j’ai le coeur gros. « People make mistakes ». Cette phrase m’avait marqué pour sa véracité et sa simplicité dans la série Fleabag. Dans The Whale, c’est ce que l’ensemble des personnages nous disent : qu’ils font des erreurs, et on leur répond que rien n’est grave dans le regard sincère de l’autre, prêt à pardonner.
Un film à tiroirs comme on en voit rarement. D’abord, le huis clos dans un petit appartement à l’air confiné dont on peut presque sentir l’odeur. Puis les visites régulières que reçoit Charlie au soir de sa vie, comme un purgatoire bienveillant. L’immersion totale dans la vie d’un autre par l’écran. La lecture répétée mais jamais terminée de l’essai sur Moby Dick. Le corps massif de Charlie, montré à l’écran comme je ne l’avais jamais vu. Le besoin de vérité, de sincérité du protagoniste, qui nous envahit comme un bon vouloir nécessaire, parce que rien ne compte tant que cela n’est pas sincère, rien ne compte d’autre que la sincérité.
La nuance en permanence, la remise en cause du “tout blanc, tout noir”, y compris pour décrire l’état physique de Charlie qui se passera bien de la bien-pensance de son entourage et de ses spectateur.
Et enfin le “Est-ce qu’il t’arrive de penser que les êtres humains sont incapables de ne pas prendre soin les uns des autres ? Les êtres humains sont magnifiques”. La réplique dont les mots mêmes ne peuvent pas exprimer la force.
Le “bouleversant” en lettres capitales sur l’affiche est loin d’être un euphémisme, ce film m’a renversée de mon siège.
Et l’amour dans tout ça ?
Un bonbon pour la bonne humeur. Dans le synopsis, Lily James en documentariste anglaise et un mariage au Pakistan en vue. Je ne peux pas résister à l’appel d’un script aussi délicieux et même si quand j’arrive dans la salle, le film est finalement en VF, j’en perçois la belle ambiance, les couleurs variées, la sensibilité du personnage de Lily James et l’humour de la réalisatrice. En fait, j’attends juste le moment de revoir ce film en VOST.
Astérix et Obélix : l’Empire du milieu
Je n’ai malheureusement pas grand-chose à dire sur le sujet. Peut-être, si, que ce n’est pas simplement qu’il rivalise avec le trop bon Mission Cléopâtre : même si ce dernier n’avait jamais existé, j’aurais tout de même attendu de la part de la franchise, de la part de Guillaume Canet, quelque chose de plus drôle, de moins lourd, de moins “wink wink regardez donc cette blague”. Point positif : Gilles Lelouche reprend très bien le flambeau d’Obélix et relève un défi difficile. Le reste des défis ne sont malheureusement pas relevés…
Everything Everywhere All At Once
C’est le rafleur d’Oscar de l’année, et il le mérite bien. Un film fort original, avec une vitesse, un rythme rarement vu.
Une photo dont j’ai l’impression qu’elle marque la patte des studios A24 (si c’est possible ?). Des rires au début et des larmes à la fin. Des acteurs extraordinaires. Des décors inédits (j’ai adoré que la plus grosse partie du film se passe dans un open space ultra-déprimant et l’autre dans une laverie).
Je regrette de ne pas avoir été touchée plus que ça par la profondeur du scénario, qu’un message en particulier ne m’ait pas frappée et prise aux tripes. Peut-être à voir une seconde fois ?
Mon crime
Un vaudeville au cinéma. François Ozon a atteint des sommets dans sa carrière et s’amuse maintenant à sa guise avec un casting incroyable dans une comédie drôle et fraîche. Des questions de mise en scène demeurent sans réponse, je doute du message féministe du script. En tout cas, Rebecca Marder et Nadia Tereszkiewicz forment un duo de choc, et on espère les revoir vite ensemble à l’écran. Dany Boon est particulièrement étonnant. Malheureusement assez “oubliable” après visionnage.
Les Trois Mousquetaires
J’ai passé un plutôt bon moment devant, et je souhaite que ce film marche. Cela dit, l’épopée ne me plaît pas franchement. J’ai été triste de ne pas beaucoup aimer ce film ! En voici les raisons.
Déjà, un esprit viriliste avec des hommes beaux et sans faiblesse, et comme cela va souvent de paire, des rôles féminins trop petits et très stéréotypés (sera-ce le lot d’Eva Green que de garder le personnage de femme fatale provocatrice ultra-male gazée depuis Casino Royale ? J’accorde l’exception à Vicky Krieps dont le rôle se détache légèrement du pré-conçu).
Je ne vois pas tellement l’intérêt de présenter quatre personnages à qui tout réussit, quatre hommes à qui personne ne dit non, même pas le destin. C’est dans les échecs, dans les faiblesses, que l’on reconnaît l’imperfection humaine qui est belle à voir à l’écran.
Au-delà de cela, l’amitié entre les mousquetaires paraît extrêmement superficielle (tous prêts à mourir les uns pour les autres alors qu’il semblerait qu’ils ne se connaissent que depuis cinq minutes). Probablement aussi parce que le film s’attelle à enchaîner les introductions de personnages sans jamais les creuser. Je suis sortie du film en me demandant si Pio Marmaï avait réellement joué là-dedans, tellement je ne l’avais pas vu, mais on pourrait dire cela de tous les acteurs. Y compris François Civil, car même présent à l’écran, je n’ai nullement l’impression que le vois jouer : un enchaînement d’actions empêche toute possibilité de s’attarder sur le jeu d’acteur.
Enfin, si Illusions Perdues faisait transparaître la force de Balzac, le film ne transmet en rien la force de Dumas (j’ai tout sauf envie de lire le livre en sortant).
En espérant que la suite soit plus prometteuse, et que ce premier volet n’était qu’un passage rapide sur l’ambiance et les décors, qui sont de fait réussis.
Au bout du B
Je vous donne ici les dernières nouvelles de mon documentaire !
Le tournage lent continue. Récemment, une amie m’a dit de faire comme Agnès Varda, de filmer au gré du vent et de ce qui m’importait sur le moment. Depuis, j’amène presque toujours ma caméra à l’école, pour avoir quelques plans d’ambiance, les couchers de soleil que je n’aurais plus si tôt avec l’heure d’été.
Les interviews se sont poursuivies et pour changer, je me suis mise à interviewer mes amies en priorité. Cela donne des discussions plus fluides et m’a permis aussi de mieux les découvrir (c’est fou toutes les questions qu’on oublie de poser au quotidien !). Un grand merci encore à mes copines qui ont participé et m’ont dévoilé plein de belles choses !
Ma dernière interview date du 24 mars. Elle était extrêmement riche, pour le documentaire mais aussi pour moi, au niveau personnel.
J’ai hâte de pouvoir montrer tous ces témoignages !
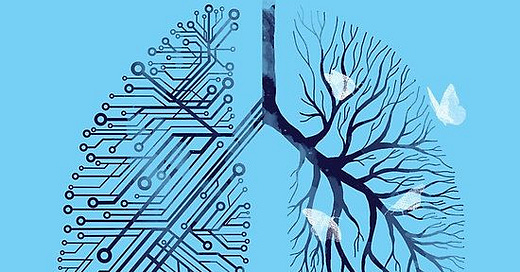















Bravo pour ce papier très inspiré et très inspirant. Je suis comme toi, ingénieur passionné de mathématiques (et particulièrement les maths inutiles) et amateur sans limites du 7ème art. Cela fait chaud au coeur de te lire et de m'identifier dans tes remarques et interrogations. Je te souhaite tout le meilleur, et je serai ravi de pouvoir voir tes oeuvres et échanger avec toi, un jour !
Et effectivement, "The Whale" m'a mis une claque magistrale... Des dialogues tellement beaux !